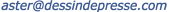|
Chapitre
I. LA PRESSE ECRITE EN BELGIQUE
|
Préambule
Dans
cette section, nous nous intéressons à la place
qu'occupent les caricaturistes dans la presse belge francophone
quotidienne actuelle. Dans un premier temps, et afin de situer
le contexte, il est question, brièvement, de l'état
de cette presse et des causes majeures - spécifiquement
belges - de son faible attrait pour les dessinateurs. Dans un
second temps, nous brossons un rapide tableau de la presse régionale,
particulièrement importante en Belgique par rapport à
la presse nationale, et de son rapport au dessin de presse. Enfin,
nous nous concentrons sur l'importance accordée aux dessinateurs
de presse dans chacun des quatre quotidiens nationaux.
§1.
Un marché en régression
Afin
de dresser l'état de santé de la presse en Belgique,
nous allons adopter deux critères: le nombre d'entreprises
actives dans ce secteur et l'évolution de leur production
au cours de ces dernières décennies. En ce qui concerne
le nombre de journaux en Belgique, nous assistons à un
net déclin. Ainsi, selon le dénombrement effectué
par Jean Gol, la presse quotidienne passa de 82 titres en 1945
à 42 titres en 1969(1). Actuellement, l'on compte 32 titres(2)
par rapport à 92 titres en 1898, soit une perte moyenne
de plus d'un quotidien tous les deux ans. Les journaux qui disparaissent
ne sont pas remplacés et les tentatives de lancement de
nouvelles publications, dont les plus significatives ont lieu
après la libération de septembre 1944, sont quelquefois
aussi fulgurantes que brèves et sans lendemain(3). Mis
à part Le Progrès, 1962, titre porté avant
la guerre par Le Journal de Mons, mais repris par l'édition
namuroise de La Nouvelle Gazette, Le Drapeau Rouge(1944(4)-1990)
et La Cité (1950-1995) sont les seuls quotidiens de l'après-guerre
qui parviennent à intéresser durant plusieurs décennies
les lecteurs belges, qualifiés par le journaliste Delforge
de "routiniers et méfiants des nouveautés",
doués d'une "admirable fidélité"(5).
Quant aux tirages, un examen de leur évolution révèle
le même phénomène de déclin. Particulièrement
déploré aujourd'hui, il n'est pas du tout récent.
Si l'on se réfère aux données divulguées
par l'Association Belge des Editeurs de Journaux (ABEJ), la baisse
des tirages s'avère constante depuis plusieurs décennies.
Ce qui laisse sous-entendre que la diminution n'en a été
que plus importante dans les chiffres réels de diffusion
(6). Le graphique ci-dessous nous montre la tendance depuis 1960,
laquelle n'est que le prolongement, étudié au niveau
local, d'un déclin général amorcé
dans l'entre-deux-guerres dans l'ensemble des pays industrialisés.
Nous sommes d'avis que ces deux critères (l'évolution
des titres et des tirages) suffisent à donner une idée
de la situation dans laquelle se trouve la presse écrite
belge, du moins par rapport à celle du début du
siècle, alors même que le dessin de presse venait
de faire son entrée dans les grands quotidiens et que les
journaux satiriques foisonnaient. Pour plus de précision,
nous devrions prendre en compte les phénomènes de
synergies et de concentration des entreprises éditrices,
ou encore nous référer à l'évolution
du recours à la publicité ou du budget communautaire
d'aide à la presse… Mais en fait, ces données
tendraient à prouver qu'il ne s'agit que d'initiatives
visant à enrayer la "spirale descendante"(7)
dans laquelle est prise la presse écrite depuis l'entre-deux-guerres:
les investisseurs (publicité, organisations politiques
et syndicales,…) sont de moins en moins attirés par
la presse à faible diffusion; or, la réduction du
budget se répercute sur sa qualité de l'information,
ce qui se traduit par une baisse du lectorat. Dès lors,
sous peine de disparaître, et après une période
de "survie", les organes de presse sont contraints d'entrer
dans une autre spirale, celle des concentrations.
Lorsque l'on replace son évolution dans le contexte européen,
l'on se rend vite compte que le marasme qui affecte la presse
écrite en Belgique n'est pas un phénomène
isolé. On peut toujours mettre en avant la naissance récente
de titres vigoureux et prospères comme La
Republica en Italie, El
Pais ou El Mundo en
Espagne et rappeler la boulimie des pays du Nord de l'Europe en
matière de presse écrite… Mais cela ne suffirait
pas à infirmer le "malaise actuel de la profession"(8)
qui affecte la plupart des pays occidentaux et dont les symptômes
sont: "les affaires et les crises internes (…), les
disparitions récentes de plusieurs grands journaux, les
alliances et les rachats parfois inattendus, (…), le désenchantement
des journalistes, etc.(9) " En Belgique francophone toutefois,
cette régression généralisée se greffe
sur un marché réduit (4,5 millions d'habitants en
Communauté française, crise économique, "un
certain manque d'intérêt pour la lecture"(10),
etc.) et souffrant de plusieurs faiblesses: "une certaine
médiocrité, une concentration excessive et la concurrence
de la presse française."(11)
1)Gol, Jean,
Le monde de la presse en Belgique, CRISP, Bruxelles, 1970,
p.121.
2)Selon FREITERMUTH, Guy, Mémento des médias
1998, éd.Kluwer, Diegem, 1997, pp. 93-94. Ce chiffre
varie si l'on considère comme "titres" à
part entière les variantes régionales d'un journal.
Selon l'émission télévisée "Contrepied"
consacrée à la naissance du Matin, RTBF du 24 mars
1998, la Belgique compte 38 titres.
3)Quelques exemples (à titre indicatif): Liberté
(quelques jours en 1944 puis, dans une deuxième formule,
d'octobre 1945 à avril 1946), L'Eclair (de novembre 1945
à mars 1946), L'Occident (de février à décembre
1946) ou Le Phare (de décembre 1946 à janvier 1949).
4)Crée en 1921, Le Drapeau Rouge avait cessé de
paraître.
(5)DELFORGE, M, Physiologie de la presse belge, in
Industries, mai 1951, cité dans Coupures de presse -
Disparition de La Cité et survie des médias d'opinion,
par l'Observatoire du récit médiatique, coll. "Médias
et société", éd. Academia Bruylant Frédéric
Antoine, Louvain-la-Neuve, 1996, p.281.
(6)L'étude des tirages est rendue difficile par le fait
que les éditeurs tiennent secrets les chiffres de diffusion
payante. Et l'on ignore pas que le tirage officiel est souvent
"gonflé" par rapport au tirage effectif. Ce nombre
est, a fortiori, de loin supérieur aux journaux réellement
achetés. (7) in Bulletin hebdomadaire de la Kredietbank,
in GOL, op.cit., p.106.
(8)WATINE, Thierry, Journaliste: une profession en quête
d'utilité sociale, in Les Cahiers du journalisme,
n°2, décembre 1996, éd. du CFPJ, Paris, p35.
(9)WATINE,
ibidem.
(10)SIMON, Christine, "Le Matin" vise un public jeune,
intellectuel et urbain, in Le Soir, 25 mars 1998, p.5.
(11)in Libération, cité par SIMON, ididem.
§2. Et la caricature dans tout ça?
A).Un
climat moins favorable
Comme
nous venons de le voir, la presse écrite est loin de
"l'âge d'or" de l'immédiat avant-guerre
1914-1918. Son déclin s'est amorcé avec l'arrivée
d'autres moyens de communication comme la radio et, surtout,
la télévision (plus récemment, le Télétexte
et l'Internet). Comme le dit Guy Bohère, "la lumière
chasse le plomb"(1). Quant au dessin de presse, il rencontre
également la concurrence de la photographie mais l'impact
de celle-ci semble se répercuter davantage sur le style
graphique - naguère, le dessin devait aussi être
figuratif - que sur sa fréquence d'utilisation. En fait,
si l'on s'en souvient, la "grande période de la
presse écrite" est essentiellement celle de la presse
d'opinion (presse satirique incluse), qui faisait un grand usage
de la caricature. Avec le rétrécissement du marché,
la partition idéologique qui caractérise cette
presse commence à s'estomper. Sans disparaître,
bien évidemment: en 1970, Jean Gol remarque que "la
division politique de la presse est beaucoup plus grande que
dans les pays voisins. Il y a peu de quotidiens neutres en Belgique"(2).
Mais il précise plus loin que "de nombreux journaux
libéraux et catholiques, catalogués de la sorte
par tradition, sont tentés d'opérer la mutation
qui les ferait passer eux aussi dans la catégorie des
neutres.(3) " Postés en première ligne, les
dessinateurs n'ont d'autre choix que de suivre ce mouvement
descendant, orienté vers le "centre". Quelques
journaux très marqués politiquement conserveront
leurs dessinateurs attitrés (La Cité, Le Drapeau
Rouge et surtout Pourquoi-Pas?), tandis que la presse satirique
disparaîtra, à l'exception de l'hebdomadaire Pan
qui emploie toujours deux dessinateurs.
Le résultat de la détérioration de la conjoncture
économique dans le monde de la presse belge est double
et se fait ressentir au niveau du dessin de presse. D'une part,
la configuration de la presse régionale est sans cesse
remodelée, afin de permettre aux organes de presse de
rester compétitifs. Son nouveau visage, très changeant,
n'est d'ailleurs pas sans opposition à celui de l'ancienne
presse, qui fournissait un cadre idéal pour la caricature:
alors qu'à la fin du XIXème siècle, les
journaux, même au niveau local, se livraient à
de véritables combats politiques (notamment avant des
élections(4)), ceux d'aujourd'hui passent des accords
de "coopération rédactionnelle" et de
"coopération publicitaire", de "non-concurrence".
D'autre part, si la presse nationale actuelle s'articule toujours
autour du schéma politique (socialistes, catholiques,
centristes et libéraux), elle se présente comme
une version édulcorée, assagie, de son ascendante.
Dépendant d'un lectorat de plus en plus méfiant
à l'égard des idéologies, désintéressé
par la politique et disparaissant (de mort naturelle), le marché
belge est désormais trop restreint pour permettre à
une presse d'opinion de prospérer. D'où cette
"neutralisation", dictée par la nécessité
de ne pas limiter son lectorat au nombre des individus de même
obédience, autrement dit, de "ratisser large"..
(1)BOHERE,
Guy, Profession: journaliste. Etude sur la condition du journaliste
en tant que travailleur, éd. du Bureau International
du Travail de Genève, Genève, 1984, p.47.
(2)GOL, op.cit., p.21.
(3)GOL, op.cit., p.51. (4)A ce sujet, voir La caricature
en Wallonie 1789-1918, éd. du Musée de la
Vie Wallonne, Liège, 1983, pp. 5-7.
B) Asepsie
Dans
ce contexte, la seule caricature capable de subsister est une
caricature qui ne révèle pas trop d'engagement
politique - mais éviter l'excès dans une caricature
politique est difficile, puisqu'il s'agit d'une "caricature"
-, inoffensive, aseptisée. A contrario, un dessin politique
trop engagé, fût-il bon, n'intéressera peut-être
qu'une minorité de lecteurs, deviendra ésotérique
pour les autres ou leur paraîtra d'un autre âge.
Fabrice Jacquemart rappelle à juste titre que "il
y a un petit côté "intello" dans le dessin…
Daumier ne faisait pas des caricatures pour tout le monde, mais
pour un certain public. Comprendre un dessin, cela relève
déjà d'une démarche d'initié."
Dès lors, un journal ne peut accorder trop de place à
un dessin qui est d'office vu par tous les lecteurs mais qui
ne plairait qu'à certains, en déplaisant éventuellement
à d'autres. A cela s'ajoute la rémunération
du dessinateur, lequel, en outre, occupe l'espace publicitaire
potentiel. Ces conditions réunies ajoutées au
contexte économique difficile, on comprend la relative
"frilosité" de la presse belge (au plutôt
francophone) en matière de dessin de presse. Mais, comme
nous allons le voir, certains signes laissent présager
un regain d'intérêt.
Si nous nous permettons de parler de "frilosité"
de la presse belge francophone en matière de dessin de
presse, c'est suite à deux réflexions:
Tout d'abord, l'ensemble de nos interlocuteurs avancent que
les caricaturistes français et flamands "vont plus
loin": ils sont plus engagés, plus politiques, plus
caustiques, etc. Nous constatons que plusieurs rédacteurs
en chef avec qui nous avons conversé (notamment des rédacteurs
de la presse régionale, contactés par téléphone)
se disent intéressés par les dessins mais affirment
que l'on ne trouve pas, en Wallonie, de "bon dessinateur"
politique, au sens ou nous l'avons décrit dans la partie
II (chapitre II, §2) . Ils donnent pour preuve les nombreuses
caricatures que les rédactions reçoivent régulièrement:
elles sont médiocres, tant au niveau des idées,
qu'au niveau de la forme… Autrement dit, la "faiblesse"
du dessin de presse en Belgique serait due aux dessinateurs
de presse. Or, il nous semble que cet argument dissimule un
simple désintérêt pour la chose, car - sans
mettre en doute les facultés de jugement de qui que ce
soit - combien sont les photographies médiocres, les
articles médiocres, et parfois même les dessins
médiocres qui sont finalement publiés?
Un deuxième constat repose sur les affirmations des dessinateurs
eux-mêmes. Ceux-ci saluent l'engagement de la plupart
des caricaturistes français (et flamands lorsqu'ils les
connaissent) qu'ils n'attribuent pas systématiquement
et uniquement à plus de souplesse de la part des médias.
Mais, la plupart de nos dessinateurs avouent avoir dû
"mettre de l'eau dans leur vin" et nous avons peine
à croire que leurs premiers dessins aient étés
poujadistes. Et nous ne parlons pas ici de l'autocensure, que
tous les dessinateurs pratiquent.
Ceci tend à prouver que, malgré leur prétendue
recherche de "bon dessinateurs politiques", les rédactions
se montrent prudentes - marché oblige…- quant à
la marge de manœuvre à leur accorder. Il est également
surprenant d'entendre les rédacteurs en chef se dire
"prêt à accorder une place à un dessinateur
- "ce que je sens, dit Fabrice Jacquemart, c'est que tout
le monde veut en avoir un" - alors que l'on sait combien
l'offre est abondante: (pour la presse nationale) "Environ
une proposition par semaine, de la part d'un illustrateur différent"
(Jean-Paul Duchâteau), "Environ une tous les quinze
jours" (Guy Duplat), "Moins de une par mois"
(Michel Marteau). Les jeunes illustrateurs, déplore-t-on,
sont si peu intéressés par l'actualité
et par la politique…
|