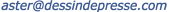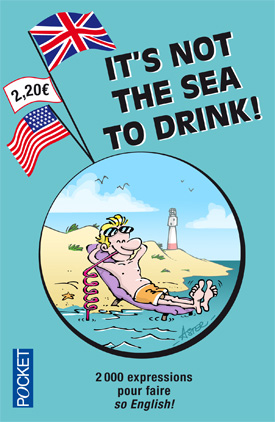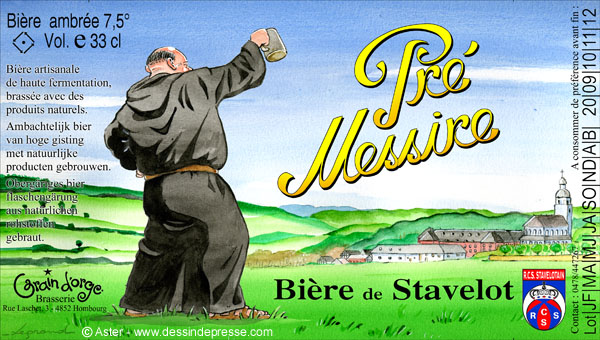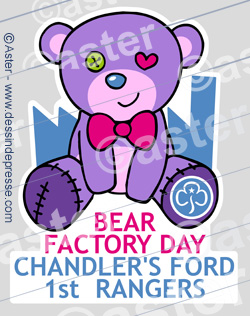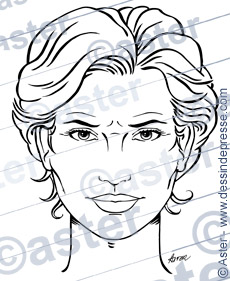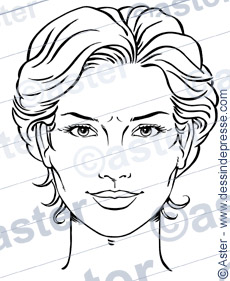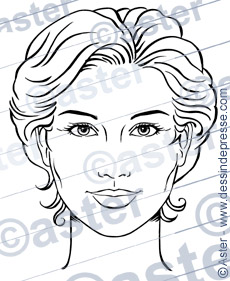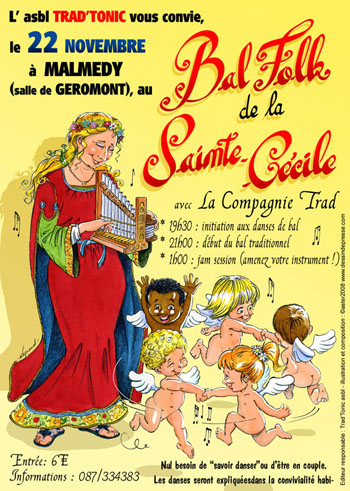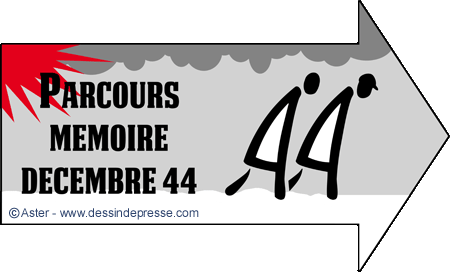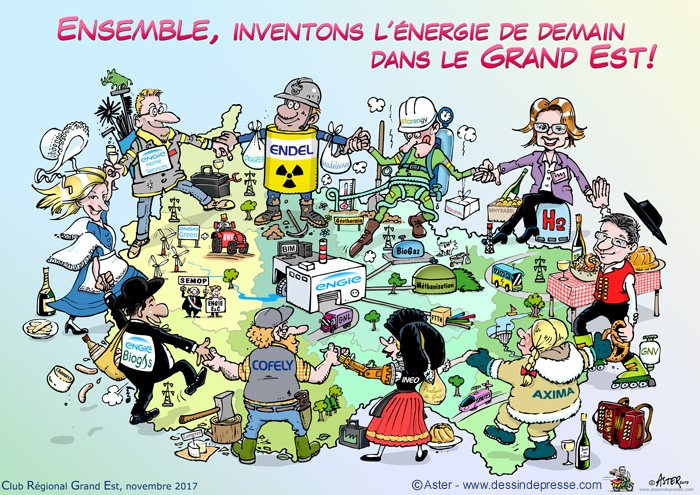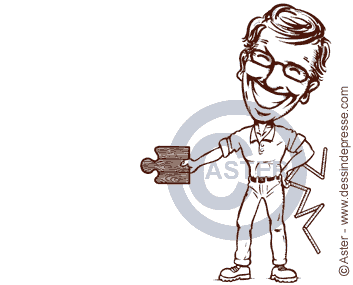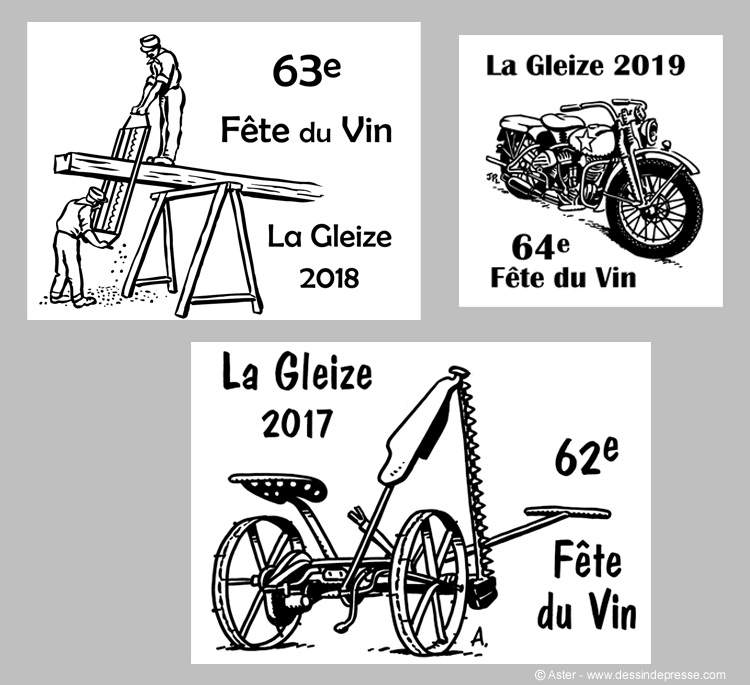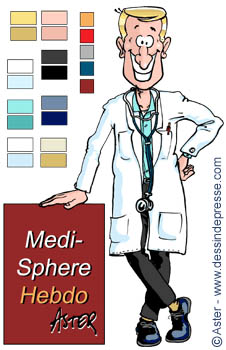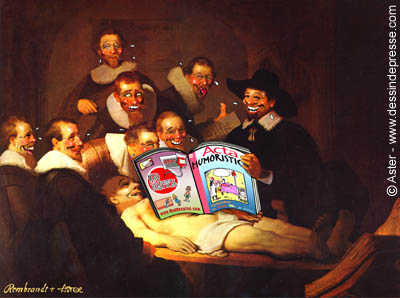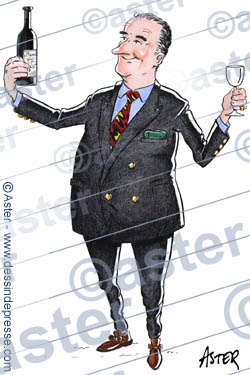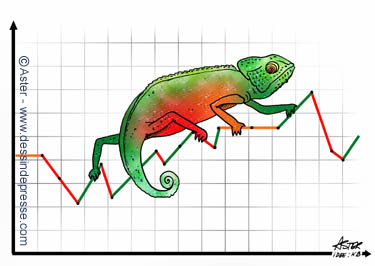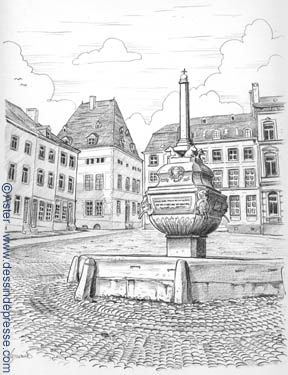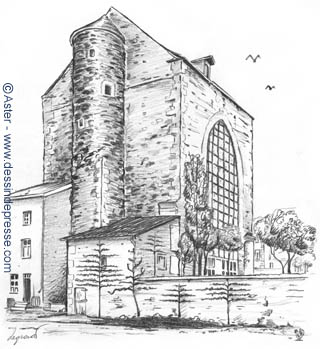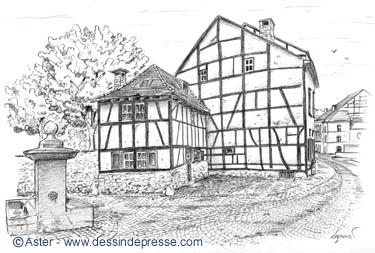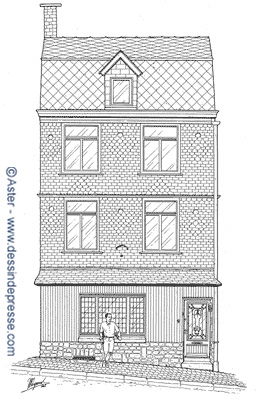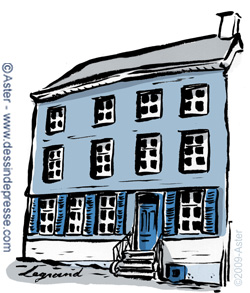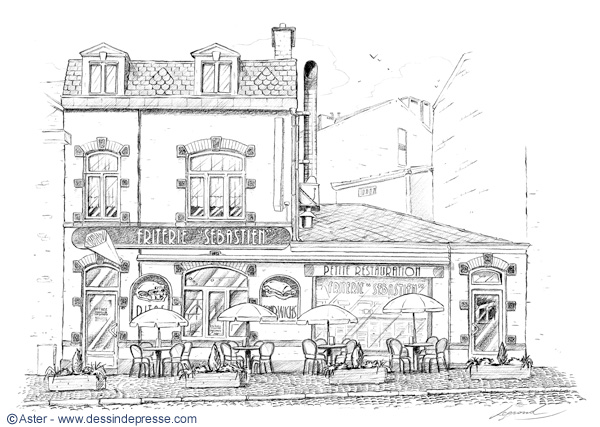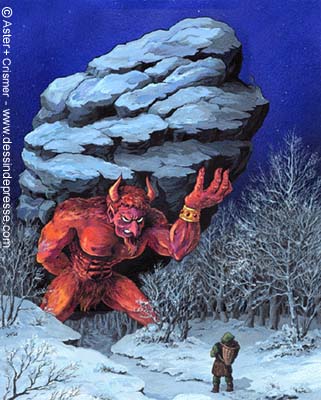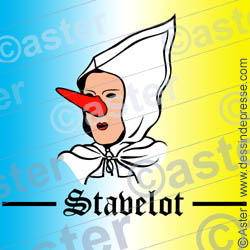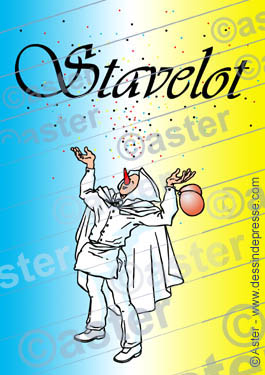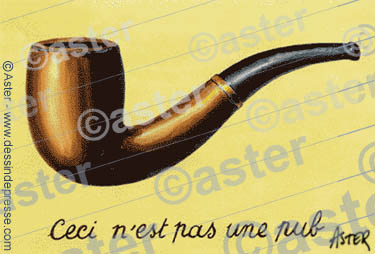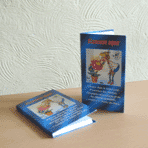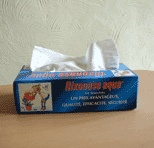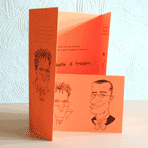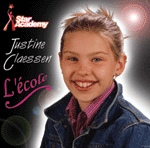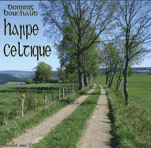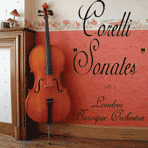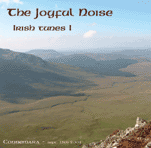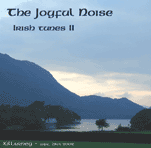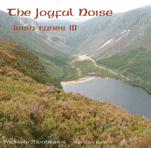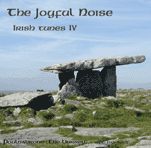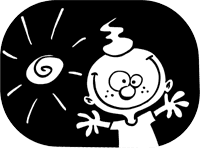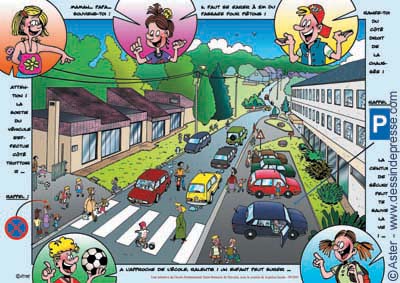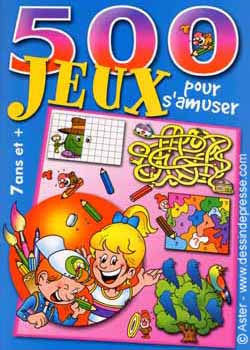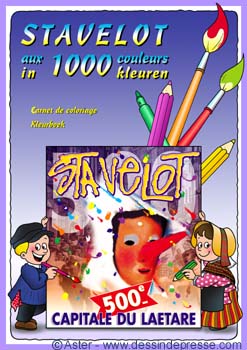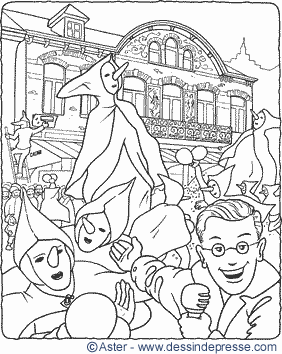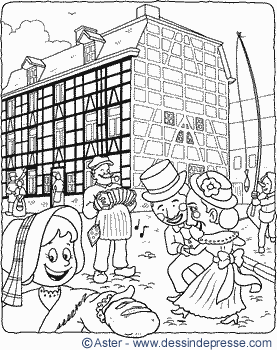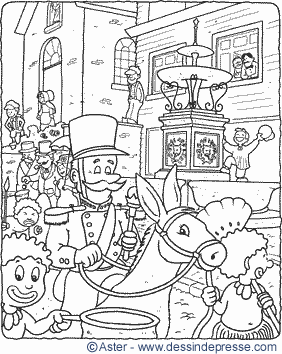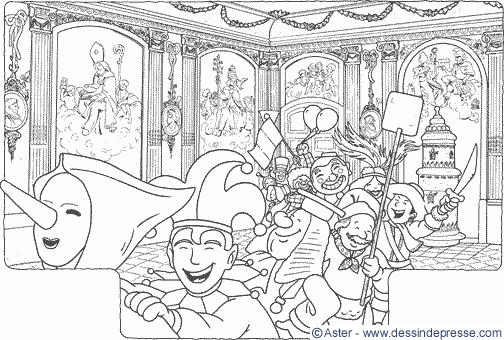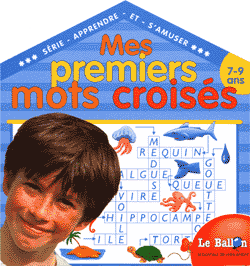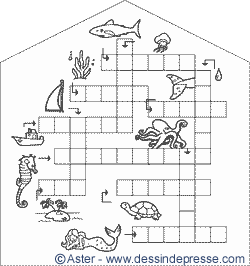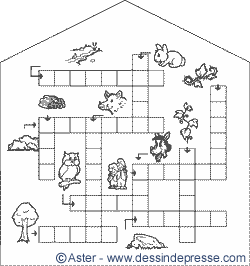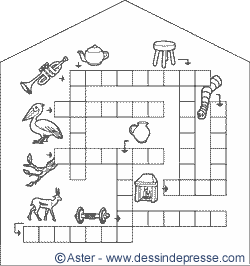|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vous
visitez la page
Illustrations et dessins en styles variés
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LES
FONCTIONS du DESSINATEUR DE PRESSE.
Extrait
de Etude du rôle social et de
la fonction journalistique des dessinateurs dans la presse quotidienne
nationale en Communauté française de Belgique,
mémoire de fin d'étude de Jean-Philippe
Legrand - alias "Aster" depuis 1999 - , Université
de Liège, 1998.
Le
dessin de presse est un moyen d'expression parmi d'autres. Dans
un journal, il y a des informations, des analyses, des commentaires,
des reportages, des infographies, des photos... et le dessin
est aujourd'hui un des éléments constitutifs d'un
journal moderne.
Jean-Paul
Duchâteau
Le dessinateur de presse est tout à la fois :
§1.
Un illustrateur
Illustrateur...ou artiste au sens propre. Ici, les deux termes
sont équivalents, dans la mesure où tous deux renvoient
au sens de l'esthétique, à la créativité,
au savoir-faire du dessinateur de presse, par opposition à
ses capacités de commentateur de l'actualité. Cet
aspect de la profession mérite une attention particulière
dans la mesure où dans de nombreux cas, il prend le pas
sur tous les autres aspects, le monopole des idées revenant
aux journalistes rédacteurs (les amalgames sont d'ailleurs
fréquents entre les métiers de dessinateur de presse
et illustrateur de bandes dessinées ou de livres pour enfants).
Vu sous cet angle, le dessin en tout genre sert à diversifier
les formes d'illustrations, suppléer aux photographies
manquantes, présenter des données d'information
de façon originale.
Dans une première acception, "illustrer" signifie
orner, ornementer, décorer. L'illustrateur est celui qui,
avec le photographe, le graphiste et le metteur en page, confère
à une publication sa valeur, sur un plan esthétique.
L'importance accordée à cette dimension est très
variable selon les dessinateurs et les supports: les capacités
de l'un, les contraintes techniques de l'autre et bien entendu
leurs choix délibérés et respectifs en la
matière déterminent une multitude de cas de figures.
Elle entre plutôt dans les considérations de la presse
hebdomadaire (référons-nous aux compositions très
colorées, très originales et très techniques
de Vadot, Cécile Bertrand , Vince...) mais ceci mériterait
d'être expliqué et nuancé longuement.
Dans une seconde acception, "illustrer" signifie rendre
plus clair, par un exemple, une mise en situation, une vulgarisation
propres à toucher un maximum de lecteurs. En plus de son
côté purement figuratif, l'illustration permet au
lecteur de ressentir et de comprendre l'essentiel d'un problème
exposé dans un article. A en croire les journalistes, sa
remarquable complémentarité avec l'écrit
prend des allures de concurrence: "les gens veulent plus
d'illustrations. L'illustration parle de plus en plus...",
nous dit M.Marteau, de La Dernière Heure. Puis il concède
que "les journalistes savent très bien que même
les gens trop pressés ou pas trop intéressés
par les articles regardent les dessins". En effet, alors
que les photos présentent une certaine figuration de la
réalité, certains dessins ont un tel pouvoir d'évocation
et de suggestion qu'ils résument à eux seuls un
concept ou une idée abstraite. A condition bien entendu
de pouvoir s'y arrêter et d'en extraire, comme disait Rabelais,
la "substantifique moelle".
|
Texte
: ©aster1998 -Toute reproduction interdite, soumise
à autorisation.
|
§2.
Un commentateur
Le caricaturiste de presse n'est pas seulement le manipulateur
d'une sorte de "poésie graphique" dépourvue
d'engagement et mise au service d'opinions extrinsèques.
Il se plaît au contraire à donner son interprétation
d'un événement, laquelle est appréciée
et attendue par de nombreux lecteurs, et à exprimer ses
idées parfois les plus engagées. A la manière
d'un rédacteur de commentaires, le dessinateur suggère
une lecture fondée sur sa propre compréhension de
l'actualité. Mais le dessinateur de presse ne se contente
pas de donner sens à l'événement, il le connote
abondamment, comme dans un billet d'humeur, ou le condamne radicalement.
Son avantage tient à l'éventail des procédés
ironiques dont il dispose ainsi qu'aux différents niveaux
de lecture d'un dessin, qui le prémunissent contre les
critiques d'ordre moral, religieux, politique et même légal.
Pour les lecteurs confrontés à l'objectivité
des faits, sa prise de position constitue un éclairage
- plus ou moins modeste selon les dessinateurs - , une piste pour
la formulation de jugements, une référence par rapport
à laquelle ils se positionnent eux-mêmes.
Dans certains cas où il bénéficie d'une grande
visibilité, à la "une" par exemple, le
"commentaire expressif" que constitue le dessin peut
devenir l'expression de tout le corps rédactionnel. C'est
ainsi que l'on assimile souvent son auteur à un éditorialiste.
Jean-Paul Duchâteau, explique son point de vue: "Le
dessin a un impact beaucoup plus grand, beaucoup plus fort que
ne peut l'avoir un article. Et si, dans un article, on peut mettre
beaucoup de nuances, c'est beaucoup plus difficile dans un dessin.
L'impact éditorial des dessins est énorme."
Cet avis est prudent et en rappelant ce qui distingue le dessin
d'un article, Jean-Paul Duchâteau se garde bien d'identifier
le dessin de presse à un éditorial. Le moment est
venu d'ouvrir une parenthèse sur une des pierres d'achoppement
de l'étude du dessin de presse: est-il, oui ou non, un
éditorial?
Pour
notre part, nous pensons qu'il faut rendre à l'éditorialiste
ce qui appartient à l'éditorialiste. L'éditorial
au sens strict se veut nuancé, méticuleux, rigoureux;
il pèse le pour et contre, il fait le tour de la question.
Il a le cheminement de la pensée rationnelle, qui constate,
se remémore, dégage des rapports de causes à
effets, analyse, tranche puis se met en question, argumente, élabore
des prévisions et enfin conclut prudemment. Il est une
persuasion qui s'adresse à la raison des lecteurs. L'éditorialiste,
un journaliste chevronné qui apparaît comme sage
et mesuré, prend une distance et un surplomb qui l'élève
"au-dessus de la mêlée". Enfin, il n'est
pas garanti que tout le monde lit l'éditorial, encore moins
que c'est la première chose qui est lue.
Le
dessin en revanche - prenons même un dessin politique de
page une, "aux allures d'éditorial" -, se montre
univoque , tranché, engagé. Il met en lumière
un aspect essentiel du fait d'actualité. Et s'il lui arrive
de présenter plusieurs éléments, ceux-ci
s'appellent et se renforcent pour appuyer une et une seule conviction.
Son action est brève et efficace: une perception soudaine,
une prise de conscience, un "insight". Il est l'instantané
d'une situation et s'adresse en priorité à la sensibilité
des lecteurs. Quant au dessinateur, ce grand enfant un peu idéaliste,
si l'on excepte quelques dessins symboliques ou grandiloquents,
il se situe davantage en contrebas, dans la mêlée,
d'où il siffle les mauvais acrobates du cirque social.
Si, pour ces raisons, le dessin de presse n'est pas un éditorial
digne de ce nom, il est encore moins un éditorial "caché"
: visible plus que toute autre chose dans le journal, il est "lu"
par tous les lecteurs et, pour bon nombre d'entre eux, c'est la
première chose sur laquelle ils s'arrêtent. Peut-être
est-ce parce que, comme le dit René Andrieu (L'Humanité),
"il est plus agréable à regarder?"
Avant
d'en terminer, il convient également de rendre à
Plantu ce qui appartient à Plantu. Considéré
à bien des égards comme la figure de proue du "dessin
de presse francophone", personne ne songe à remettre
en question la fonction d'éditorialiste de Jean Plantureux
au Monde. Sa situation en première page, son professionnalisme,
son autorité, son expérience, sa diffusion, etc.
font de lui une exception propre à justifier le fait que
tout auteur autre que Plantu ne peut revendiquer le titre d'éditorialiste
sans éprouver un léger sentiment d'abus et d'usurpation,
envers ceux dont le métier est d'éditorialiser "dans
les règles de l'art". En Belgique, si les dessinateurs
de presse sont conscients de l'efficacité de leurs productions
qui, par ailleurs, engagent parfois la responsabilité de
toute la rédaction, ils n'ignorent pas non plus la modicité
des moyens mis en oeuvre. Tous ont par conséquent l'humilité
de ne pas s'octroyer le titre pompeux d'éditorialiste.
En définitive, le dessin aurait plus d'impact qu'un éditorial,
il ne serait pas autre chose qu'un succédané simplificateur
et bien moins éclairé. Mais les avantages à
tirer de cette ambivalence sont nombreux et sont heureusement
considérés par les principaux organes de presse
belges. Le dessin comme "élément contributif
de la politique éditoriale d'un journal", selon l'expression
de Jean-Paul Duchâteau, tel est le constat mais aussi le
choix des trois journaux nationaux que sont Le Soir, La Libre
Belgique et La Dernière Heure.
|
Texte
: ©aster1998 -Toute reproduction interdite, soumise
à autorisation.
|
§3. Un adjuvant communicationnel
Dans cette sous-section, nous allons nous concentrer sur les multiples
avantages du dessin de presse en tant qu'aide à la transmission
de l'information et à la lecture du journal. Ils sont regroupés
autour de trois fonctions principales: les fonctions d'appel,
articulatoire et mnémotechnique du dessin de presse. Nous
ne les rapporterons pas systématiquement à une qualité
particulière du dessinateur mais nous ne perdrons pas de
vue qu'il s'agit de son rôle, effectif ou potentiel, que
nous essayons de préciser. Nous verrons en quoi il contribue
à la mise en valeur, la mise en forme et la mise en mémoire
de l'information journalistique.
A) Fonction d'appel
Pour une majorité de dessinateurs et de rédacteurs
en chef, le "vrai bon" dessin de presse est celui qui
dispense de lire le papier qu'il accompagne. Or, il arrive qu'un
dessin même très pertinent ne constitue pas un espace
sémantique clos et requière la lecture préalable
du texte qu'il illustre. Le pouvoir d'attraction qu'il exerce
d'abord sur lui-même est ainsi dévié vers
le texte et la volonté de comprendre le dessin vient s'ajouter
aux motivations du lecteur. Dans ce cas, le dessin n'est plus
simplement juxtaposé à l'article mais induit, oriente
et éventuellement relance la lecture. D'une façon
plus générale, le dessin assure une certaine "ergonomie
de lecture " du journal, qui va de l'éveil de la curiosité
à la figuration du thème traité. En prenant
pour exemple la politique, "qui n'est pas toujours simple
à suivre, Guy Duplat confirme que "le rôle du
dessinateur est aussi de permettre que les gens rentrent plus
et mieux dans les textes, dans l'actualité (...) prennent
goût à ça et lisent les articles".
|
Texte
: ©aster1998 -Toute reproduction interdite, soumise
à autorisation.
|
B)
Fonction articulatoire
Pour préciser le sens de cette "ergonomie de lecture",
il convient d'évoquer le rôle que joue le dessin
dans l'organisation et plus particulièrement l'enchaînement
des informations. Dans tous les médias, on dénote
un vif intérêt pour tous ces éléments
singuliers, originaux, atypiques qui, au lieu de constituer du
bruit (interférence), accompagnent et facilitent tout le
processus de mise en forme, de transmission et de réception
des messages. Il s'agit des sonals (jingles), des bruitages ,
des intermèdes musicaux, des commentaires humoristiques,
des génériques utilisés en radiophonie et,
avec les infographies, en télévision. Dans le domaine
du multimédia se sont ajoutés à ces éléments
une kyrielle d'objets graphiques utilitaires, décoratifs
ou d'animation: puces, barres, fonds, mais encore cliparts, GIF
animées, smileys... On peut constater que, face à
cette évolution des mass media à la fois cause et
conséquence des goûts et habitudes du public, la
presse d'information demeure un média relativement peu
convivial. Néanmoins, elle semble évoluer elle aussi
- timidement - vers une utilisation plus fréquente d'éléments
graphiques animateurs et articulatoires.
es "cabochons" (appelés aussi "vignettes"
ou "culs-de-lampe") sont de petits ornements dessinés
qui introduisent une rubrique ou séparent les unités
successives d'une séquence d'information. Ils sont de petits
dessins symboliques qui permettent aux lecteurs de se retrouver
dans le journal et dans la plupart des cas de se faire une idée
sur le style, le ton, le thème des textes qui suivent.
Dans
d'autres cas, ils annoncent certaines rubriques habituelles, conférant
par leur récurrence une certaine homogénéité
à la publication ou, au contraire, la variété
qui lui manque éventuellement. De cette façon, ils
font office de surtitres, d'intertitres, de filets horizontaux et
rythment la présentation de l'information tout en en brisant
le "géométrisme".
Pour séparer les différents volets d'une enquête,
introduire les divisions d'un dossier, ponctuer les étapes
d'un long reportage ou d'une chronique (voir page suivante), on
utilisera de préférence des dessins plus grands, plus
travaillés, bref plus illustratifs.
Un
cas particulier de dessin comme élément d'accompagnement
et de transition est la mascotte ou, par extension, tout personnage
apparaissant dans les pages de façon récurrente. Ce
procédé est surtout utilisé par les publications
dites de la "presse périodique" (presse spécialisée,
d'entreprise, d'association, commerciale...). Dans la presse
d'information, afortiori quotidienne, l'on ne voit guère
que des petits Père Noël durant les fêtes de fin
d'année et des petits sportifs en période des Jeux
olympiques. Comme nous avons pu le voir, le dessinateur de presse
incarne également les rôles de présentateur
et d'animateur. C'est ce qui explique la place qui lui est réservée
dans certaines manifestations telles que des conférences,
des colloques ou des débats télévisés.
En fonction de l'importance qui lui est accordée, de ses
capacités et du déroulement de l'événement,
il pourra, par le biais de ses créations, faciliter l'enchaînement
des sujets, faire réagir les participants, entretenir l'intérêt
du public et éventuellement conclure.
L'utilisation de dessins est très fréquente dans les
rubriques comprenant elles-mêmes plusieurs divisions, telles
que les sports, l'horoscope, les programmes TV, etc.
|
Texte
: ©aster1998 -Toute reproduction interdite, soumise à
autorisation.
|
C)
Fonction mnémotechnique
Dans de nombreux domaines, l'image se présente comme un support
privilégié de communication, dans la mesure où
ses multiples propriétés (concision, instantanéité,
chromatisme, etc.) lui permettent d'être intégrée
par les lecteurs sans requérir de leur part la même
quantité d'efforts que pour un message verbal. En psychologie
de la perception, cette "force de la forme" inhérente
à l'image est appelée prégnance et s'observe
particulièrement au niveau de la mémorisation. Les
schémas présents dans certains manuels scolaires,
les symboles du bulletin météorologique, les photographies,
logotypes et autres "slogans graphiques" utilisés
lors des campagnes publicitaires ou électorales ne sont pas
davantage des illustrations décoratives que des moyens mnémotechniques
destinés à optimiser la portée des messages.
En presse écrite, dont la responsabilité dans la rétention
de l'information par le lecteur pourrait être longuement débattue,
la caricature garantit à celui qui s'y arrête un meilleur
rappel des données qu'elle contient, et ce, peut-être
plus encore qu'une manchette ou une infographie .
Aux
qualités d'impact mémoriel de l'image s'ajoutent les
effets d'une position engagée à l'égard d'un
événement. Le cartooniste belge Gal, qui se dit "en
premier lieu journaliste" témoigne: " Les gens
oublient trop vite mais si on est incisif et qu'on le reste, alors
il y a des chances pour qu'ils retiennent quelque chose" .
La plupart des dessinateurs confirment qu'il ne faut pas hésiter
à bousculer les consciences ou même choquer pour être
entendu et marquer les lecteurs (sans nécessairement verser
dans le "bête et méchant" et autres excès
hara-kiriens). D'une façon plus générale, la
rétention d'un message est, entre autres facteurs, proportionnelle
au "degré d'atypicité" de sa forme et de
son contenu par rapport aux messages environnants ou habituels,
en l'occurrence les articles et les photographies peu distincts
entre eux. Pour nous rendre compte de cette persistance des dessins
de presse dans les mémoires - les études font défaut
à ce sujet -, il suffit d'interroger les lecteurs de notre
entourage.
Avant
de clore ce chapitre, nous épinglerons encore parmi les catalyseurs
mnésiques la modification par le dessin de l'état
moral ou sentimental des lecteurs. Le rappel d'une information peut
s'effectuer via le souvenir d'un sentiment de gaieté (avoir
réagi au gag), d'affliction (le message était bouleversant),
de satisfaction (avoir compris le dessin), de perplexité,
de révolte, d'étonnement... Evidemment, ces propriétés
- non exhaustives - extraites par nous des dessins et considérées
comme très influentes ne jouent pas toujours de tout leur
poids et il est un fait que les dessins moins "bons" ou
mal mis en valeur laisseront la majorité indifférente.
|
Texte
: ©aster1998 -Toute reproduction interdite, soumise à
autorisation.
|
§4. Un "fidélisateur"
Pour comprendre les caricatures à ses multiples degrés
et réussir tous ces "tests de closure" qui parsèment
le quotidien, il ne suffit pas toujours de dominer l'actualité.
La connaissance du caricaturiste, de ses habitudes, de ses opinions,
de son style, de la personnalité qu'il exprime au travers
de ses dessins bref une certaine complicité est un atout
majeur. Quand ils ne vont pas jusqu'à adresser dans leurs
dessins des clins d'oeil à des personnes précises
de leur entourage, les caricaturistes aiment faire référence
à leurs créations antérieures, réutiliser
leurs trouvailles (ces petits éléments qui symbolisent
ou accompagnent les personnalités représentées),
étaler un gag sur plusieurs numéros, aller de plus
en plus loin dans la polémique ou dans la subversion...
"Il faut amener les gens petit à petit à vous
suivre, à vous accepter, explique Royer. Il y a une osmose
qui se passe entre les lecteurs et le dessinateur". Au même
titre qu'un chroniqueur, le dessinateur de presse contribue à
la fidélisation du public pour un journal donné. Le
lecteur s'impatiente de connaître son avis sur les derniers
soubresauts de l'actualité ("le Royer" de la page
2 du Soir). Le lecteur se réjouit de retrouver son journaliste
préféré dans Les vacances de Clou dans La Libre
Belgique ou de voir quel sera le gag à l'ordre du jour dans
les Carnets du major Compote dans La Dernière Heure.
|
Texte
: ©aster1998 -Toute reproduction interdite, soumise à
autorisation.
|
§5.
Un "brouilleur de cartes" (consistance et contrepoint)
Il est un fait que si les journaux accordent un espace relativement
large aux caricatures, ce n'est pas par mécénat mais
par intérêt pour leur apport remarquable dans la transmission
d'une information filtrée et critiquée. En règle
générale, elles se doivent d'être consistantes,
c'est-à-dire non-contradictoires, avec l'esprit de la publication.
"C'est exactement la même chose que pour un journaliste,
assure Jean-Paul Duchâteau, il faut qu'il y ait une adhésion
générale et globale aux valeurs défendues par
le journal (principes éditoriaux, professionnels, éthiques...)."
En raison de sa visibilité, le dessin de presse est donc
un appui important à la politique d'un journal. Mais, si
nous prenions l'exemple de dessins à la fois "percutants"
et consistants, nous pourrions nous étonner de l'engagement
excessif de son auteur, et conclure à la fonction de militant
du dessinateur de presse. Or, il convient peut-être de réserver
ce terme à ses homologues du XIXème, lesquels soutenaient
de leur traits acidulés une presse d'opinion et de propagande
s'alimentant du carrousel catholico-libéral, ou à
un "Alidor dont le fascisme était tellement criant qu'il
en devenait folklorique"(du Bus). De nos jours, les clivages
politiques se font plus discrets et la presse, aseptisée,
est peu friande d'opinions extrêmes. Et si le dessin permet
quelquefois de faire passer plus facilement certaines idées
plus engagées d'un journal, il y va rarement d'une démarche
savamment ourdie.
Les
dessinateurs ne reçoivent généralement pas
de consignes d'ordre idéologique les encourageant à
dénigrer tel adversaire ou à encenser tel autre. Ils
connaissent les publications pour lesquelles ils dessinent; ils
"sentent" en général jusqu'où ils
peuvent aller et éventuellement ce que l'on attend d'eux.
Pour des sujets plus délicats, on leur rappelle certains
faits et l'on se contente de leur adresser quelques recommandations
afin, comme dit Clou, de "prévenir les fautes de goût".
Seul Pévé admet avoir été plusieurs
fois aiguillé de façon manifeste lorsqu'il collaborait
à Pourquoi pas?: "Il faut taper sur Untel",
lui disait-on, "A propos de ..., tu peux y aller...".
Mais il serait erroné de croire que ces consignes tendent
toujours à rapprocher le journal de sa ligne rédactionnelle.
Les dessins sont quelquefois utilisés lorsqu'il s'agit d'épingler
les travers de ceux que le titre appuie habituellement ou de neutraliser
- équilibrer - les critiques formulées à l'encontre
d'une famille de pensée donnée. Ainsi, au moment des
"affaires" belges, on demande à Clou de faire "quelques
dessins "attaquant" le PSC, en contrepoint, pour ne pas
tomber dans un anti-socialisme exagéré". De son
côté, mais délibérément, Kroll,
que l'on dit "plutôt de gauche", n'hésite
pas à railler le PS dès son entrée au journal
Le Peuple. De tels dessins sont au journal ce que des cartes de
voeux réalisées pour le PRL sont à Kroll
lui-même: un contrepoids, un gage d'indépendance et
de crédibilité, une façon de brouiller les
cartes... de parti.
|
Texte
: ©aster1998 -Toute reproduction interdite, soumise à
autorisation.
|
§6.
Un "personnalisateur" (personnalisation et responsabilisation)
Non seulement le dessinateur de presse est à l'origine d'un
apport esthétique dans la composition des pages du journal
mais il peut en général y déployer toute sa
personnalité. Sa subjectivité éclatante y côtoie
l'objectivité placide des rédacteurs et la familiarité
de ses phylactères y joue de plein contraste avec le langage
châtié des éditorialistes. On peut affirmer
qu'il est de ceux qui confèrent au journal un visage plus
"humain", plus convivial. Dans cet exercice, c'est la
mise en scène de personnages (la personnalisation), qui s'avère
la plus efficace. Par cette technique, ou plutôt cette habitude,
le dessinateur contrecarre l'anonymat des données d'information,
qui est moins désiré par les lecteurs qu'imposée
par une société en marche vers une "dépersonnalisation"
effrénée. Sans doute est-ce le danger de perdre peu
à peu le contact avec le lecteur qui pousse non seulement
les organes de presse mais aussi toutes les institutions dotées
d'appareils médiatiques à collaborer avec des dessinateurs,
des comédiens ou des humoristes. La personnalisation est
d'ailleurs très pratiquée par la presse à sensation
qui s'en sert afin d'entretenir et d'augmenter la proximité
psychologique avec le lecteur.
Formule d'attrait mais aussi "subjectivation" de l'actualité,
la personnalisation introduite par le dessinateur de presse répond
également au besoin de "reliance sociale" qu'éprouve
tout individu. La mise en scène d'hommes et de femmes stéréotypés,
catégoriels, voire familiers, au profil psychologique évident,
assimilables à une collectivité particulière,
entretient chez le lecteur divers sentiments d'appartenance et de
distinction. Dans certains cas, la représentation de personnages
dans un contexte donné suscite l'identification du lecteur
et sollicite de sa part une prise de position. Dans d'autres cas,
ils sont de petits interlocuteurs qui adressent au lecteur des messages
l'invitant à rallier une cause ou une opinion. En somme,
faire intervenir Monsieur-tout-le-monde dans la mise en scène
de l'actualité par le dessinateur, c'est non seulement établir
des rapports de connivence avec le lecteur mais aussi le placer
devant ses responsabilités.
|
Texte
: ©aster1998 -Toute reproduction interdite, soumise à
autorisation.
|
§7.
Un "vivificateur"
Si l'on n'a jamais calculé l'influence des dessins de presse
sur les ventes d'un journal, on sait l'importance que revêt
l'illustration en général (photographies, dessins,
infographies), et en particulier le dessin humoristique. A tel point
que les dessinateurs affirment de façon quasi unanime qu'aujourd'hui,
tout le monde veut des petits dessins. Des bulletins d'associations
aux journaux d'entreprise, en passant par les débats télévisés
et les conférences, nombreux sont les supports qui tiennent
à parfaire leur mise en page par les illustrations ou à
accroître leur convivialité au moyen de dessins d'humour.
On peut, avec Mac Luhan, parler de "réchauffement"
des médias, mais c'est en fait une autre préoccupation
qui sous-tend la démarche de bon nombre d'intéressés,
à savoir dynamiser leur image de marque.
Le dessinateur pratique un art qui s'adresse à tous, mais
qui plaît en général à un public relativement
jeune et toutefois suffisamment instruit pour l'apprécier.
Le dessinateur de presse lui-même est assimilé à
un "grand enfant", large d'esprit et pas toujours très
tendre. Son humour mis au service d'une institution ou d'un orateur
est propre à ôter les excès de prétention
et à faire montre de son sens de l'autodérision. Enfin,
son trait tantôt vif et lapidaire, tantôt rassis et
éloquent, amène quand il le faut l'énergie
du jeune cadre ou le recul du sage. Toutes ces qualités font
du dessinateur une sorte d'orfèvre du capital symbolique
et, par conséquent, un collaborateur fort prisé par
les entreprises, les agences de publicité, les associations,
les partis politiques...
A
côté de leur contribution à des brochures de
toutes sortes, les dessinateurs sont présents sur de nombreux
terrains : Serdu est régulièrement sollicité
pour animer des soirées, des salons, des cocktails, des foires;
Saive se rend en France pour animer des séminaires organisés
par de grosses firmes commerciales; Franx fréquente les festivités
bourgeoises pour caricaturer les invités; Geluck place son
Chat dans les filières du "merchandising"...
Un exemple particulièrement significatif est donné
par Kroll qui a participé à une campagne publicitaire
"qui avait pour but d'affirmer auprès du public l'image
de la CGER, banque dynamique et de plain-pied avec son époque."
Aujourd'hui, il se voit sollicité pour étendre sa
collaboration à la nouvelle politique de communication développée
par l'Université de Liège. A d'autres occasions, il
parvient à vendre son écriture dégingandée
dont aucune police de caractère ne parvient encore à
égaler la richesse. Les partis politiques sont également
friands de ce genre d'apport: on se souviendra de la campagne de
Jean-Luc Dehaene , en 1985, illustrée par Brasser ou encore
les six affiches publicitaires détournées en 1987
par Francis Carin et Jean-Louis Lejeune à la faveur d'une
promotion du gouvernement de Wilfried Martens .
|
Texte
: ©aster1998 -Toute reproduction interdite, soumise à
autorisation.
|
§8.
Un représentant
A l'instar de tout journaliste, le dessinateur est, dans chacune
de ses manifestations, le représentant de l'organe de presse
qui l'emploie. Un représentant de poids étant donné
sa renommée souvent plus étendue que celle de la plupart
des journalistes et une visibilité qui n'a rien à
envier aux photographes. Ses dessins sont, comme le confirment les
rédacteurs en chef, un élément fort de l'identité
du journal, "plus fort que le commentaire, qui doit être
lu, précise Fabrice Jacquemart. Le dessin fait partie de
l'identité graphique" du journal, insiste-t-il, ce qui
est très important. Mais il n'y a pas que la forme; les opinions
véhiculées par les dessins sont également représentatives
de l'esprit général de la publication. C'est donc
le style du dessinateur, dans toutes ses facettes, et son adéquation
aux options rédactionnelles qui font que, comme Royer selon
Guy Duplat, "il joue un grand rôle et est clairement
identifié au journal".
La
représentativité du dessinateur est également
vectrice de rapprochement ou de distanciation du lecteur par rapport
à un journal. Ceux qui sont capables d'apprécier le
ton politique de Royer ou de Clou sont des lecteurs potentiels du
Soir et de La Libre Belgique et ceux qui trouvent des affinités
avec Gérard, Moto ou Emilio sont susceptibles d'adhérer
également au style de La Dernière Heure ou de La Meuse.
Le caricaturiste assure donc une certaine promotion de son journal
auprès d'un public spécifique. Par ailleurs, le dessinateur
étant un travailleur indépendant, il lui arrive de
se produire en dehors du journal (publication de recueils, animation
de conférences, participation aux émissions télévisuelles
ou radio-diffusées...). Il devient alors proprement un
ambassadeur dont le succès (ou l'insuccès) peut avoir
des répercutions sur l'image de marque du journal et, comme
le fait remarquer Jean-Paul Duchâteau, sur toute la rédaction:
"Quand Clou est reconnu à l'extérieur, c'est
un sentiment de fierté général".
|
Texte
: ©aster1998 -Toute reproduction interdite, soumise à
autorisation.
|
§9.
Le dessinateur à la rédaction du journal
Le tableau ne serait achevé si l'on n'évoquait l'apport
du dessinateur à toute la rédaction. Dans la presse
belge, aucun dessinateur ne possède à proprement parler
de bureau dans la rédaction même (à l'exception
d'Emilio à La Meuse, qui a un statut de journaliste et qui
exerce les fonctions de graphiste et à l'occasion de rédacteur).
Contrairement à plusieurs de leurs homologues français,
tous ont un statut d'indépendant par rapport à leur
journal et travaillent à domicile ou sur le lieu de leur
emploi principal. Ils ont donc peu de contacts avec leurs collaborateurs
et l'on ne peut pas dire qu'ils "rayonnent" sur toute
la rédaction, en grand boute-en-train. Néanmoins,
il ressort de nos entrevues avec les dessinateurs et les rédacteurs
en chef que leur influence sur le climat général n'est
pas nulle. Le caricaturiste apporte peut-être une chaleur,
une certaine fraternité, un peu de détente dans un
milieu où l'on travaille de manière assidue, concentrée
et solitaire. Chacun de ses dessins suscite des réactions
parmi les journalistes, à fortiori ceux dont il illustre
le papier: certains aiment, d'autres moins, on discute de sa pertinence
et de son opportunité, on envisage quelles pourraient être
les réactions des lecteurs et si éventuellement, il
convient de le revoir ou de ne pas le publier... Certains dessins,
dont ceux destinés à cet effet uniquement, sont accrochés
aux murs de la rédaction: des caricatures, des coups de gueule,
des leitmotive, etc. Quant à la présence même
du dessinateur, elle n'est requise que lors de grands événements
tels qu'un anniversaire du journal, une restructuration, un aménagement
ou une grande prise de position.
De
tous les dessinateurs rencontrés, Clou semble être
celui qui a le plus de contacts avec les autres journalistes. Il
essaye, dans la mesure du possible, de participer aux conférences
de rédactions, qu'il perturbe parfois par des dessins rapidement
exécutés, mais il intervient aussi dans les débats.
"On est tous très heureux dans la rédaction d'avoir
trouvé, enfin, un excellent illustrateur", déclare
Jean-Paul Duchâteau. Clou remarque cette fierté qui
ressemble à celle d'une grande famille qui a vu naître
le petit dernier. Il l'interprète en observant que "le
fait que le journal a enfin un cartooniste" accroît chez
les journalistes de La Libre Belgique le sentiment de réaliser
"un vrai journal, capable de faire la même chose que
Le Monde ou Le Soir. " (et de citer Gabriel Ringlet: "Le
cartoon a sauvé Le Monde! ") Cet avis n'est tout de
même pas partagé par le rédacteur en chef qui
objecte que la présence de dessins n'est pas ce qui "raffermirait
ou qui affaiblirait le caractère de référence
d'un journal". Du côté de La Dernière Heure,
le rédacteur en chef adjoint confirme l'influence positive
du dessinateur sur l'ambiance du lieu de travail en prenant l'exemple
de Gérard qui, comme les autres caricaturistes mais avec
l'audace qui le caractérise, "envoie des dessins sur
le thème demandé et dont il sait très bien
qu'on ne les publiera pas parce qu'ils sont volontairement choquants,
trop érotiques... Mais ils font rire la rédaction."
Au Soir, Royer apporte ses dessins quotidiennement et a lui aussi
peu de contacts avec les journalistes, juste le temps de discuter
de l'actualité et du dessin. Vu son expérience et
sa position dans le journal, Royer ne laisse pas ses collaborateurs
indifférents. "C'est quelqu'un qui a un poids, assure
Guy Duplat. C'est quelqu'un aussi que l'on apprécie, qui
est très très agréable, que l'on connaît
bien. Il fait partie intégrante de l'ensemble de la rédaction".
Enfin, il confie: "C'est une star!"
|
Texte
: ©aster1998 -Toute reproduction interdite, soumise à
autorisation.
|
***
|
|
Le
dessin de presse désigne une illustration
décalée, généralement
humoristique et caricaturale, destinée à
communiquer ou commenter une information à
un public cible (ici, les collaborateurs d'une même
société, ou les clients). Aujourd'hui,
l'appellation appelation internationale "cartoon"
tend
à supplanter chez nous celles d'illustration,
de caricature ou de dessin de presse, en
particulier en communication d'entreprise. Le dessin
de presse considère l'idée avant la
forme, qui tend souvent, dès lors, vers un
maximum de simplicité.
|
Illustration
de couverture pour une collection Pocket.
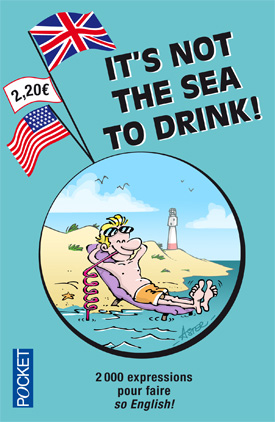
Etiquette de la bière "Pré Messire".
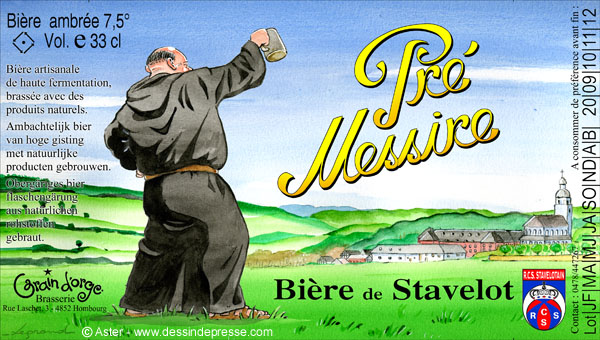
Ecusson pour les Girlguiding Chandlers Ford
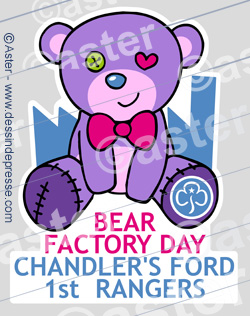
Illustration technique
afin de présenter la modification des traits
du visage grâce à un traitement esthétique.
Affiche de bal
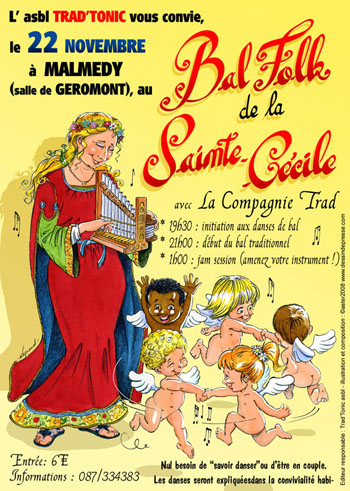
Série d'illuustrations réalisées
pour un manuel sur la communication de Klüber
Lubrication
Panneaux de balisage d'un parcours dédié
à la mémoire de l'Offensive
Commune de Stoumont.
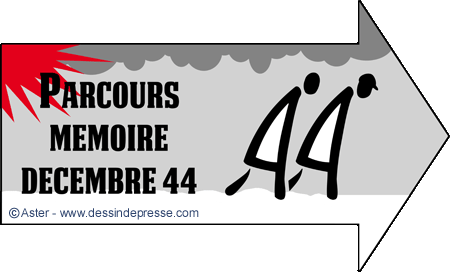
Poster présentant les médtiers d'Engie
et la situation du Grand Est
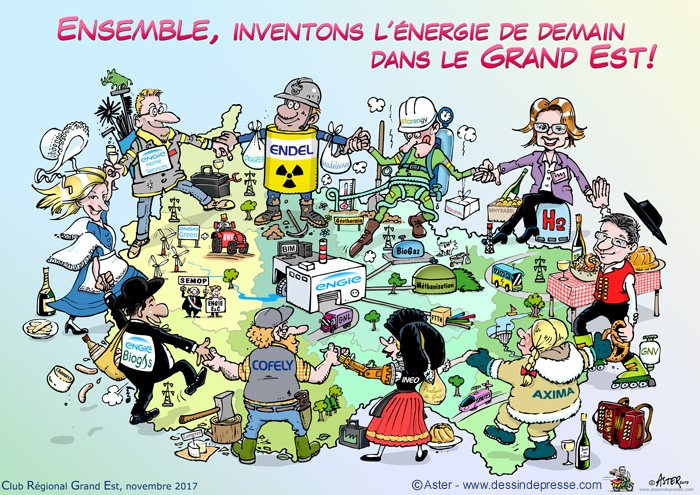
Petit visuel pour un parcours découverte de l'Abbaye
de Stavelot

Visuel réalisé pour l'entreprise de menuiserie
Jacquemotte, spécialisée dans les aménagements
spécifiques de bâtiments.
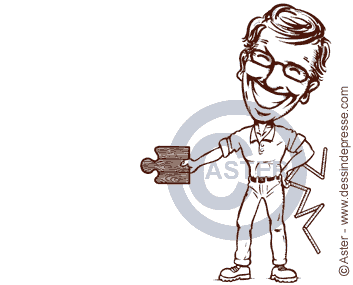
Visuel réalisé pour les verres de vin
produits annuellement à l'occasion de la fête
de La Gleize
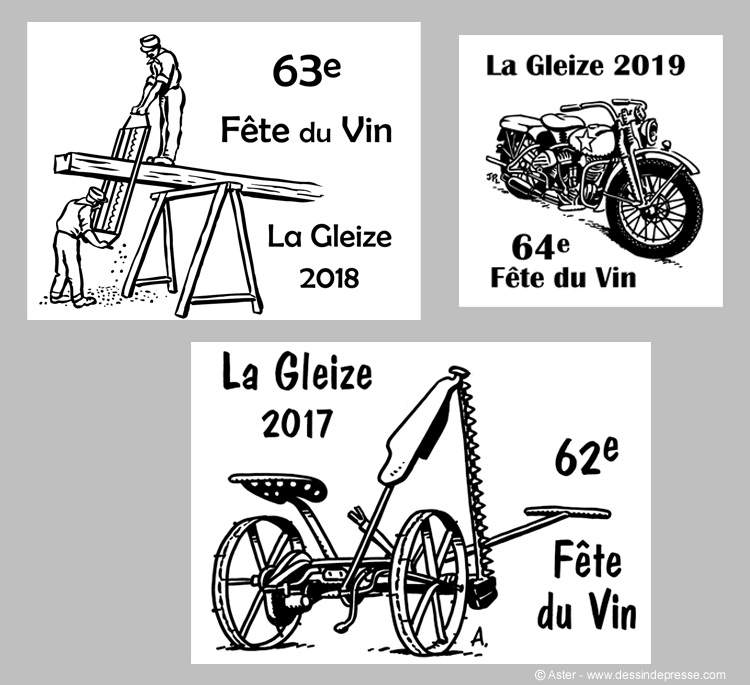
Créé pour RMN (Reflexion Medical Network)
Le "Docteur Medi-Sphere" - ©Aster
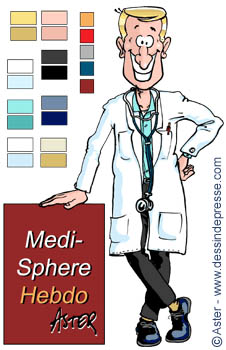
Réalisé pour Violon&Violon
Promotion du magazine d'humour médical Acta
Humoristica
(Pastiche de La leçon d'anatomie du docteur
Tulp, de Rembrandt)
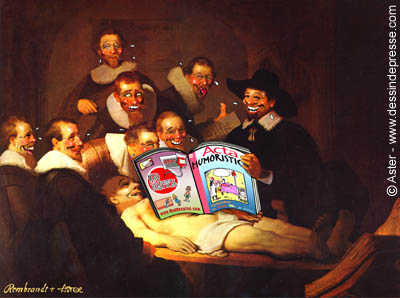
Les 10 étapes de la dégustation
du vin (extraits), Société Vine
& Vineyards, Angleterre - (Encre, aquarelle,
42 X 29,7 cm)
Dessiné pour le magazine interne de Winterthur
Article sur l'adaptation de l'entreprise
aux fluctuations des marchés.
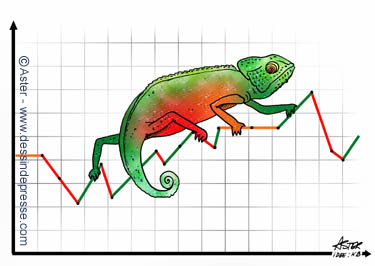
Réalisé pour un collectif de défense
du travail des femmes
en illustration d'un article intitulé "Femme-mosaïque".

***
CREATIONS LOCALES
Ferme dans les environs de Stavelot,
au XIXème S.
NB : Ces croquis ont été réalisés
pour le livre de Michel Vanderschaeghe "
Stavelot - C'était au temps du 19ème
siècle". 53 vues sont disponibles.
Me contacter.

|
L'entrée
de l'Abbaye de Stavelot au au XIXème
S.
|
La
Place Saint-Remacle, à Stavelot,
telle qu'elle était au XIXème
S, avec son perron.
|
|
|
|
La tour de l'abbaye de Stavelot au au XIXème
S.
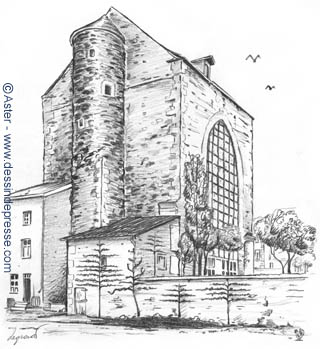
|
Maisons
à colombages de la Rue Haute.
|
Rue
haute, perspective inverse.
(maison appartenant par le peintre Marcel
Hastir)
|
|
|
|
Autres demeures à Stavelot
Illustration de la légende locale de "la
Pierre du Diable" à Stavelot
(gouache, 50x70 cm) - Couleurs: L. Crismer
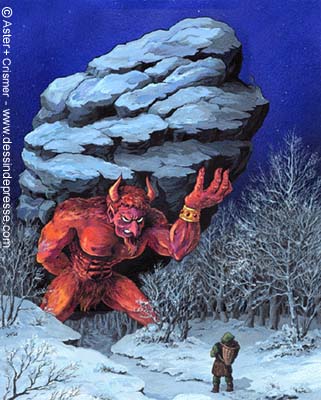
Autocollants à l'effigie du Blanc-Moussi,
personnage fétiche de
la ville de Stavelot dont les couleurs sont le
bleu, le blanc et le jaune
Illustration
typiquement belge d'une situation politique typiquement
belge
face à la directive européenne d'interdire
la publicité pour le tabac,
particulièrement au circuit de Francorchamps,
situé sur la commune de Stavelot.
(pastiche du célèbre tableau de
Magritte, feutre, aquarelle)
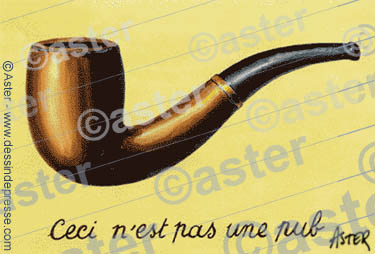
***
CREATIONS DIVERSES
|
|
|
|
|
|
Etiquettes
|
Bloc-notes
|
Emballages
|
Invitations
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pochettes
CD (face)
|
Pochettes
CD (dos)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T-shirts
|
GIF
animées
|
Retouche
de
|
photographies
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fresques
(cliquer pour aggrandir)
|
Panneau
|
Pare-soleil
|
|
NB:
Les pochettes CD montrées ci-dessus ont été
créées à partir de photographies
personnelles. Réalisées dans le but d'un
usage privé, elles n'ont fait l'objet ni de publication,
ni de commerce.C'est également le cas des titres
auxquelles elles font référence.
DESSINS POUR LA JEUNESSE (réalisations
2000-2003)
Panneau
2m x 1,20m réalisé pour un établissement
scolaire,
dans le cadre d'une campagne de sécurité
routière.
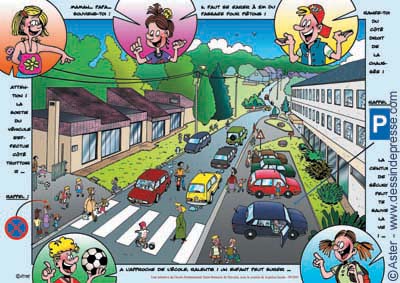
|
Couverture d'une brochure d'information
pour l'asbl "COALA"
 |
Recueil de jeux entièrement réalisé
pour les Editions Caramel
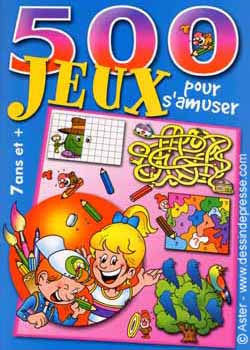 |
Carnet de coloriage
dans le cadre de la promotion de la ville de Stavelot.
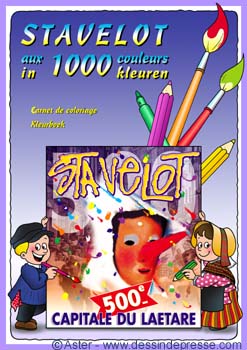 |
|
|
Carnet
de coloriage
dans le cadre de la promotion de la ville
de Stavelot.
(Détail de quelques pages intérieures)
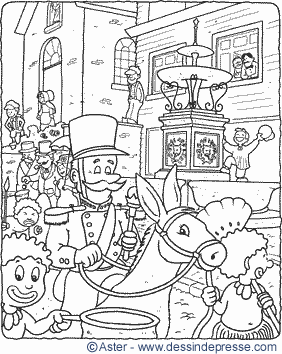
|
|
|
|
|
|
|
|